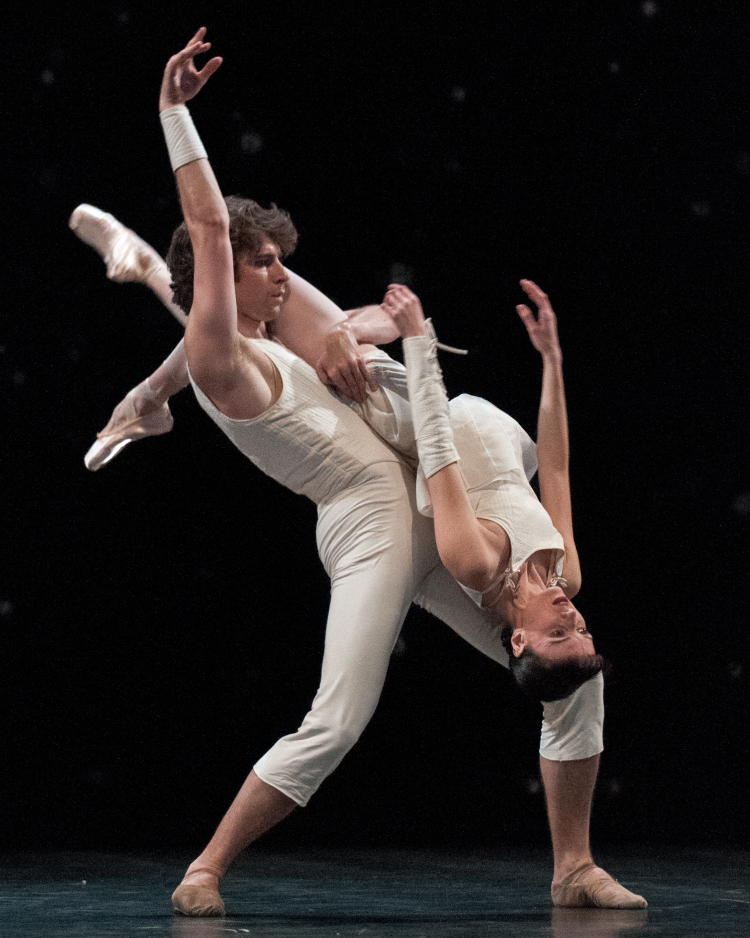La musique
Jonas Kaufmann et Anja Harteros, l’un des plus beaux couples d’opéra de notre temps, transfigurent l’opéra égyptien de Verdi sous la direction brûlante de Sir Antonio Pappano.
L’essentiel
- Une œuvre éminemment populaire, synthèse du grand opéra français et du mélodrame italien.
- Une production conjuguant stylisation (décors, costumes) et lecture contemporaine, capable de fédérer un très large public.
- Une superbe double distribution mêlant chanteurs de renommée internationale (Saioa Hernandez, Piotr Beczala, Gregory Kunde) et artistes de grand talent faisant leurs débuts à l’Opéra national de Paris : Ewa Plonka, Alexander Köpeczi ou encore Enkhbat Amartüvshin considéré, avec Ludovic Tézier, comme le meilleur baryton verdien actuel.
L’argument
En Égypte à l’époque des pharaons. L’amour du général égyptien Radamès et de l’esclave éthiopienne Aida est d’emblée menacé par la guerre que vont se livrer leurs deux pays. L’autre danger qui les menace s’appelle Amneris, fille du roi d'Égypte, éprise de Radamès : Aida, son esclave, est ainsi, par la force des choses, sa malheureuse rivale. La victoire des troupes égyptiennes est totale et vaut un triomphe à Radamès, à qui le roi offre sa fille Amneris en récompense. Mais, de glorieux héros, Radamès va bientôt devenir paria de son pays, amené à trahir les siens en confiant d’importants secrets militaires à Aida, missionnée par son père, le roi d’Éthiopie Amonasro.
L’héritage
En Italie, en 1872, alors que Verdi est déjà au faîte de sa gloire, la réception d’Aida devient un étalon à l’aune duquel juger d’un triomphe. Les succès à venir seront « à la Aida », ou ne seront pas. Mais garde-t-on trace de manifestations semblables à celles qui accompagnent la création de l’œuvre à Milan ou à Naples : rappels sans fin – jusqu’à 32 au moins –, le compositeur porté de la salle du théâtre San Carlo jusqu’à son hôtel par une foule en liesse, réunie en cortège sous ses fenêtres pour scander de plus belle sa marche triomphale du deuxième acte, ou la baguette d’ivoire ornée d’une étoile en diamant dont on lui fait cadeau à l’issue du spectacle. À l’origine de cet engouement formidable, un opéra non moins prodigue en faste et en démonstrations. Répondant à une commande du khédive Ismaïl Pacha pour l’inauguration du nouvel opéra du Caire, mais surtout séduit par un livret qu’il juge écrit « d’une main très experte », Verdi travaille à une reconstitution grandiose des rites et des processions de l’Égypte antique, attentif aux trouvailles archéologiques dont il est le contemporain. La filiation avec le grand opéra à la française ne fait pas de doute, avec ses effets de masse, son chœur à emplois multiples, ses fanfares et ses hymnes ici teintés de sonorités orientales. Mais Aida est un joyau qui ne se réduit pas à la beauté de son serti : enchâssés dans la fresque « péplum », perlent en effet des prières déchirantes, des airs et des duos intimistes à l’écriture musicale particulièrement raffinée, aux nuances irisées, pendant plein de soie aux éclats des trompettes dorées. La pompe militaire et l’éclat zélé des prêtres, le luxe de leur apparition, sont finalement accessoires du drame sentimental et ne valent qu’en rapport avec le dilemme des personnages dont ils accusent chacune des stations et dont ils amplifient la dimension tragique dans les scènes d’ensemble. Une dualité féconde qu’instaure d’emblée le prélude en faisant planer sur le thème rêveur d’Aida celui des prêtres et de leurs intercessions fatales.
« Tout ce que je fais est très stylisé […] Dans des œuvres qui touchent au réalisme magique et aux rêves, les idées peuvent transcender les spécificités d’une culture et d’une époque »
(Shirin Neshat, Artland Magazine, 2022)
Le parti pris
En 2017 au festival de Salzbourg, Shirin Neshat présentait au public une mise en scène épurée, à rebours des séductions orientalistes, mais conservait les grands effets, les aspects rituels et processionnels du livret indispensables à la qualification des pressions auxquelles sont soumis les principaux protagonistes. Reconnaissant dans l’œuvre les stigmates universels des tyrannies politiques dont Verdi désignait déjà les armes, la puissance militaire et le fanatisme religieux, la metteuse en scène iranienne puise dans l’actualité et son expérience personnelle de femme exilée, partagée entre l’Orient et l’Occident, la matière d’une vision critique tantôt nettement située, tantôt syncrétique pour favoriser l’universalité de son propos. Shirin Neshat stylise mais ne fait pas l’impasse sur la violence des rapports de domination qui président aux destins des peuples, des hommes et des femmes, souvent les premières à porter le deuil de la liberté et à devoir souffrir le choix de la résignation ou de la résistance.
Au cœur de la production
Le dispositif abstrait conçu par Christian Schmidt (un vaste plateau tournant sur lequel sont disposés deux grands éléments cubiques ouverts sur deux côtés), sert d’écran aux projections, le plus souvent en noir et blanc, de la cinéaste et plasticienne. Si elles se fondent dans l’esthétique monumentale du grand opéra et servent la poésie visuelle de l’ensemble, les images de Shirin Neshat – des territoires écrasés de soleil, des scènes de guerre et d’exactions – augmentent surtout la profondeur de champ du livret, porteuses d’une réflexion sur l’Histoire et ses bégaiements tragiques. Des images puissantes, comme les regards des hommes et des femmes qu’elles plantent dans les nôtres pour conjurer le silence et l’oubli.
OPÉRA EN QUATRE ACTES, 1871
En langue italienne
Mise en scène
SHIRIN NESHAT
Nouveau spectacle
Direction Musicale*
MICHELE MARIOTTI / DMITRY MATVIENKO
Distribution*
SAIOA HERNÁNDEZ / EWA PŁONKA
AIDA
PIOTR BECZAŁA / GREGORY KUNDE
RADAMES
EVE-MAUD HUBEAUX / JUDITH KUTASI
AMNERIS
Orchestre et Chœurs de l'Opéra national de Paris
3h05 avec 1 entracte
*pour les dates précises de direction musicale et distribution, se référer au site internet de l'Opéra national de Paris.